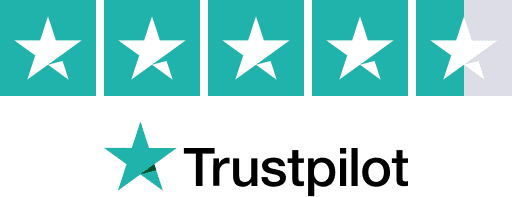Sommaire

La voiture électrique est encore régulièrement décriée pour son impact supposé négatif sur l’environnement, notamment la fabrication de sa batterie au lithium-ion. Pourtant dans la majorité des cas, elle a un meilleur impact qu’une voiture thermique. Pour en avoir le cœur net, revenons ici sur les fondamentaux : quel est vraiment le bilan carbone d’une voiture électrique ? Quelles pistes peut-on envisager pour réduire cet impact dans les années qui viennent ?
L'empreinte carbone en bref
Définition
L’empreinte carbone est un indicateur qui vise à mesurer l’impact d’une activité sur l’environnement, et plus particulièrement les émissions de gaz à effet de serre liées à cette activité. Dans le cas concret des voitures, il s’agit de comptabiliser les tonnes de gaz à effet de serre émis par :
- la combustion de l'essence ou la consommation d'électricité pendant les trajets
- le transport et l’extraction du pétrole pour créer cette essence ou de l'uranium pour la production d'électricité
- l'extraction et le transport des matières premières pour la fabrication de la voiture et des batteries spécifiques aux voitures électriques
- la fabrication des voitures dans les usines ainsi que leur transport jusqu'au client
Quels sont les gaz à effet de serre associés ?
Le dioxyde de carbone (CO2) est le gaz à effet de serre le plus répandu. Sachez néanmoins qu’il en existe cinq autres ! Mais dans le cas précis des véhicules à essence, la loi Euro 6 impose depuis 2014 un plafond d’émissions pour 6 polluants distincts :
| Types de polluants | Taux d'émission maximum (g/km) |
|---|---|
| Monoxyde de carbone (CO) | 1,000 |
| Hydrocarbure (HC) | 0,100 |
| Oxydes d'azote (NOx) | 0,060 |
| Hydrocarbure + Oxydes d'azote | - |
| Particules (pour un moteur à injection direct) | 0,005 |
| Hydrocarbures non méthaniques (HCNM) | 0,068 |
Plafond d'émission défini par la loi Euro 6 pour un véhicule essence
Bilan carbone d’une voiture : ⅓ de la pollution citadine
La voiture individuelle fait partie des 3 plus gros postes d'émissions d'un citoyen français, avec le résidentiel tertiaire (le logement) et l'agriculture. Pour un Français, la voiture représente 2,3 tCO2e/an (dont la consommation de carburants pour 1,1 t CO2e, et la fabrication et l’entretien des véhicules pour 0,5 t CO2e), selon le gouvernement.
La voiture individuelle serait responsable de 16% des émissions de gaz à effet de serre (GES) en France.
Quel bilan carbone pour une voiture électrique ?
Distinguons plusieurs étapes clefs pour faire le bilan carbone d’un véhicule électrique 🚗. Il y a :
- Les procédés de fabrication du véhicule et de sa batterie,
- Son utilisation,
- Sa fin de vie.
Émissions de CO2 liés à la fabrication
Les différentes phases de fabrication
Pour les véhicules électriques, l'Ademe distingue la fabrication du véhicule et celle de sa batterie. Elle propose les équivalences suivantes pour les facteurs d'émissions :
- Fabrication véhicule électrique ~ Fabrication véhicule thermique
- Fabrication batterie ~ Phase amont carburant
Le facteur d'émission associé à la fabrication d'un véhicule électrique de moyenne gamme est de 83.6 gCO2e/km. Très proche de la valeur publiée par Tesla dans son dernier rapport d’impact pour son modèle 3 produit aux Etats-Unis (88,55 gCO2/km).
Dans ce même rapport, notons tout de même que la batterie compte pour 45% de l'empreinte carbone de la fabrication d'une voiture ! Si les émissions de CO2 sont 30% plus élevées pour la production d’un véhicule électrique que pour un véhicule thermique, la voiture électrique ne peut que s'améliorer au niveau de l'empreinte carbone liée à la phase de production.
Bilan Carbone d’une voiture électrique pour 10 000 kilomètres
La consommation moyenne des voitures électriques se situe généralement entre 15 et 25 kWh pour 100 kilomètres.
La variation de la consommation se fait en fonction de la température extérieure, des conditions de vent et de l’habitude de conduite de l’utilisateur. On prend généralement comme valeur moyenne 20 kWh pour 100 km.
En s’appuyant sur le facteur d’émission du mix électrique français en 2020 (0,0599 kgCO2e/kWh) nous obtenons des émissions moyennes de 0,01198 kgCO2e par kilomètre pour un véhicule électrique.
En parcourant 10 000 kilomètres en France, un véhicule électrique émet donc, fabrication et utilisation incluse, environ 956 kgCO2e.
| Fabrication | 836 kgCO2e |
| Utilisation | 120 kgCO2e |
| Total | 956 kgCO2e |
Émissions de GES en kgCO2e pour 10 000 kilomètres parcourus en France avec une voiture électrique.
Est-ce qu'une voiture électrique est écologique ?
Finalement, la question se pose réellement de savoir si la voiture électrique possède un meilleur bilan carbone que sa cousine la voiture thermique ? Si la voiture électrique pollue moins lors de son utilisation mais que sa fabrication est plus énergivore, sur l'ensemble de son cycle de vie, qu'en est-il ? La voiture électrique reste moins polluante.
Les données de T&E sont nettement en faveur de l’électrique. Dans le pire des cas, avec une batterie produite en Chine et conduite en Pologne, où l’électricité est surtout produite avec du charbon, une voiture électrique émet 22% de CO2 de moins qu’un véhicule diesel et 29% qu’un véhicule essence, sur sa durée de vie totale.
L'organisme Transport et Environnement (T&E) propose un outil en ligne qui permet de mesurer les émissions de CO2 des véhicules, selon leur motorisation, leur segment et leur lieu de production. Leurs données analysent plusieurs choses :
- Si une batterie pour un véhicule électrique est produite en Chine et conduite en Pologne, on économise 22% de CO2 en moins que pour un véhicule diesel et 29% de moins que pour véhicule essence.
- Concernant la meilleure des situations, en Suède qui possède une part importante d’énergies renouvelables, un véhicule électrique génère 79% de CO2 de moins qu’un véhicule à moteur thermique !
Cela nous amène à la conclusion suivante : une voiture essence peut donc émettre trois plus de CO2.
Quant à notre cher pays, on considère que les émissions de CO2 sont 77% plus faibles pour l’électrique que pour l’essence. Sur l’ensemble de l’Union Européenne, la baisse est de 63%.
Une transition difficile
Le passage à la voiture électrique représente une rupture importante avec notre économie actuelle, encore largement dépendante des énergies fossiles. C’est une étape nécessaire mais la transition est particulièrement difficile pour la majorité des acteurs industriels en place.
Le « Diesel Gate » en constitue une bonne illustration. Considéré comme l’un des plus gros scandales industriels (et sanitaires) de ces dernières années. il a mis en lumière l’utilisation par le groupe Volkswagen, de 2009 à 2015, de différentes techniques visant à réduire frauduleusement les émissions polluantes (de NOx et de CO2) de certains de ses moteurs diesel et essence lors des tests d'homologation.

Incitations politiques
Il existe plusieurs incitations financières publiques pour inciter à passer à l’électrique. Les montants des aides varient en fonction du revenu fiscal, du prix de la voiture de votre localisation, et si vous rendez un autre véhicule.
Les plus courantes sont :
- Le bonus écologique : jusqu’à 3000€ ;
- La prime à la conversion : de 2500€ à 5000€ en restituant son ancien véhicule diesel ou essence ;
- L’exonération de la taxe régionale d’immatriculation.
Spécifiquement pour les entreprises :
- L’exonération totale de la TVS (taxe sur les véhicules de sociétés) ;
- Les amortissements non déductibles de 30 000€ ;
- L'amortissement séparé de la batterie ;
- Les avantages en nature lorsque l’employeur met à disposition un véhicule 100% électrique à un collaborateur (abattement à l’achat)
🖐 Bon à savoir : le dispositif Tremplin pour la transition écologique mis en place par l'ADEME permet d'aider financièrement les PME souhaitant remplacer leurs véhicules thermiques par des véhicules électriques.
Il existe aussi un crédit d’impôt en soutien à l’installation d’infrastructures de recharge et des aides locales de soutien pour les entreprises et les taxis franciliens, les taxis parisiens, et les particuliers dans les Bouches-du-Rhône par exemple.
Pour en savoir plus sur votre cas particulier, cliquez juste ici.
Peut-on vraiment réduire le bilan carbone d’une voiture électrique ?
En phase de fabrication
Chaque constructeur gère ses usines différemment. Dans la plupart des cas, d’importantes délocalisations ont été opérées dans les dernières décennies. En complément, des contraintes croissantes sont venues s’ajouter sur l’extraction de minerais nécessaires à l'électronique et aux batteries.

Re-localiser
D’un côté, la transformation de matières premières en matériaux ; de l’autre, l’assemblage du véhicule. Exploiter une même usine pour opérer ces 2 activités permettrait d’éviter deux étapes actuelles de transports internationaux (depuis l’usine d’assemblage et vers le client final).
Relocaliser les usines dans des pays développés permet aussi de se confronter à des normes environnementales plus exigeantes et donc de rechercher de nouveaux procédés d’extractions et de transformations plus écologiques.
Améliorer les procédés d’extraction et de recyclage de matières premières
Cela va généralement de pair avec la relocalisation. Ré-organiser l’activité d’extraction de minerais pourrait permettre d’accélérer le développement de techniques moins toxiques et plus durables d’exploitations des terres.
Quant au recyclage des véhicules électriques, il est encore trop gourmand en énergie mais qu'en sera-t-il dans quelques années ? Les méthodes de recyclage évoluent avec le temps mais atteindrons-nous le taux de recyclage des véhicules thermiques (95%), imposé en France ?
🖐 Lors du Battery-Day, Tesla a clairement annoncé rechercher des terres aux Etats-Unis pour extraire du lithium et peut-être trouver une autre manière plus écologique de produire du lithium.
Éviter l’extraction de nouveaux matériaux
Prolonger la durée de vie d'un bloc de batteries peut être encore plus efficace que son recyclage, tant pour des raisons environnementales que commerciales. Avant de mettre hors-service un bloc grand public et de l'envoyer au recyclage, un constructeur a tout intérêt à renforcer sa R&D pour prolonger la vie utile de chaque bloc de piles.
Il y a aussi le principe de closed-loop qui consiste à intégrer dans la production des produits, des matériaux issus des produits en fin de vie.
Un autre moyen de réduire le bilan carbone d’une voiture électrique : limiter le nombre de pièces utilisées - environ 30 000 pièces sont nécessaires aujourd’hui.
Produire et utiliser de l’énergie renouvelable dans les usines de transformation et d’assemblage
Reprenons l’exemple de Tesla, constructeur qui a la particularité d’être excédentaire en énergie pour la fabrication de ses voitures électriques. Il produit ainsi plus d'électricité renouvelable - via les panneaux solaires installés sur les toits - qu’il n’en utilise pour produire ses véhicules. Cela reste un premier pas, et il est évidemment nécessaire d’aller plus loin.
Limiter les dépenses marketing
Et ce n’est pas valable que pour les voitures électriques 🙃

Réduire le bilan carbone d'une voiture électrique en phase d’utilisation
Augmenter la durée de vie du véhicule et de sa batterie
Si on estime qu'un véhicule est mis à la casse après 200 000 kilomètres environ, la création d'une batterie pouvant tenir jusqu’à 1 610 000 kilomètres (soit 4 000 à 5 000 cycles de charge) réduirait considérablement les émissions par véhicule produit.
Un véhicule équipé d'une telle batterie pourrait être utilisé 8 fois plus qu'un véhicule moyen vendu en Europe. Son utilisation sur ces 1 610 000 kilomètres limiterait significativement son bilan carbone sur toute sa durée de vie.
Augmenter la part d'énergies renouvelables dans le mix électrique
Une voiture électrique consomme bien évidemment... de l’électricité. Jouer sur la part de sources de production d’énergies renouvelables dans le mix énergétique d’un pays (comme les éoliennes ou les panneaux solaires photovoltaïques) réduit mécaniquement le bilan carbone d’une voiture électrique !
Voici la liste des facteurs d'émissions des sources d’énergies de production de l'électricité. Par convention, il ne prennent pas en compte la fin de vie des installations :
Filières Nucléaire & Renouvelables
- 💧 Hydraulique - 6 gCO2e/kWh
- ☢️ Centrale nucléaire - 6 gCO2e/kWh
- 💨 Éolien terrestre - 14,1 gCO2e/kWh
- 💨 Éolien en mer - 15,6 gCO2e/kWh
- 🌋 Géothermie - 45 gCO2e/kWh
- ☀️ Solaire Photovoltaïque - 55 gCO2e/kWh
Filières Fossiles
- 🔥 Centrale gaz - 418 gCO2e/kWh
- 🛢 Centrale fioul - 730 gCO2e/kWh
- 🏭 Centrale charbon - 1 060 gCO2e/kWh
🖐 Bon à savoir : le gestionnaire de réseau de transport d’électricité RTE propose sur son site de visualiser le mix instantané de production d’électricité ainsi que les émissions de CO2e associées.
Optimiser le freinage régénératif
Lorsqu’on freine avec un véhicule électrique, on peut recharger (légèrement) sa batterie. C’est le principe du freinage régénératif ! Dès lors, optimiser cette technologie permettrait de gagner toujours plus en efficacité.
Augmenter l’efficacité du train moteur
Le train moteur qui restitue l’énergie mécanique aux roues gagnerait, lui aussi, à être amélioré. En quelques années seulement, l’efficacité en km (EPA)/kWh est passée de 5 à 7,7 km(EPA) / kWh pour les modèles considérés comme les plus efficaces du marché.
Les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat
Sur 149 propositions de la convention citoyenne pour le climat, une dizaine concerne les transports.
Repenser le bonus-malus
Inciter à l’utilisation des véhicules les moins polluants. Et proposé un bonus d’un montant maximal de 9 000 € à 10 000 € pour les pays d’Outre-mer (où le prix des véhicules est plus élevé) « en répartissant le mode de calcul entre les émissions de CO2e et le poids des véhicules. En contrepartie, le montant du malus devra être augmenté et son seuil, actuellement à 110 g CO2/kilomètre, abaissé.
Des prêts à taux zéro garantis par l'Etat
Ces prêts garantis pourraient être créés via un fonds national. Ils seraient limités à des gammes de véhicules légers et à des prix abordables.

Réduire l'usage de la voiture individuelle
Selon les 150, la voiture individuelle ne doit plus être le mode de transport privilégié des trajets domicile-travail. Pour cela, il s’agit de renforcer le soutien aux transports plus sobres, aux aménagements de l’espace public et aux contraintes de vitesses autorisées.
Le Forfait Mobilités Durables pourrait devenir obligatoire et son indemnisation être revue à la hausse, notamment dans les zones rurales ou pour les ménages précaires.
Des voies réservées aux véhicules partagés et aux transports collectifs seraient créées sur les autoroutes et voies rapides.
Une réduction de la vitesse maximale à 110 km/h sur autoroute est évoquée : « Les avantages pour le climat sont réels puisqu'ils permettent une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre en moyenne sur ces transports.». Aussi, l'allongement des temps de trajets serait léger, entre 4 à 8 minutes par heure.
Développer l'usage du train
L’idée serait de développer les trains au-delà du TGV. Pourquoi ne pas réduire la TVA actuelle à 5,5% au lieu des 10% sur le prix du billet de train ?
De bonnes pratiques à adopter au volant (dans tous les cas)
Covoiturage & Autopartage
Le poste des trajets domicile-travail est un poste souvent très important du bilan carbone d’une entreprise si les employés viennent principalement en voiture.
Le covoiturage est un des principaux leviers recommandés par la Méthode Bilan Carbone pour réduire ses émissions de CO2.
L’impact souvent négligé de la climatisation
La climatisation augmente la consommation de carburant : en ville, de l’ordre de 2 l/100 km, sur route et autoroute, environ 0,4 l/100 km et en moyenne autour de 1 l/100 km pour les véhicules les plus récents. Cela limite les progrès pourtant importants qui visent à limiter la consommation énergétique des véhicules.
- Lorsqu'elle est activée, elle provoque une surconsommation de carburant et donc des émissions de CO2 accrues (de 1 à 7 % de CO2 émis en plus par an suivant les climats, les véhicules et les usages) ;
- Qu'elle soit activée ou non, la climatisation rejette une partie du fluide frigorigène présent dans son circuit (fuites, opérations de maintenance, entretien, accident, non-récupération en fin de vie du véhicule…).
La voiture représente un poste conséquent d’émissions de GES des ménages français. Au même titre que toute autre avancée technologique, il est donc primordial de limiter dès aujourd'hui le bilan carbone de nos voitures électriques.