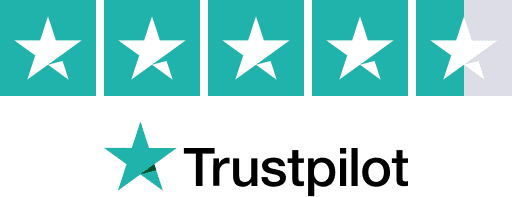Land art, green art, trash art : mêlant art et écologie, ces courants sont autant de ramifications de l'art écologique – ou éco-art – et autant de manières de s'emparer des enjeux environnementaux qui traversent nos sociétés.
Le terme d’art écologique apparaît à la fin du XXe siècle. On parlait auparavant d’“art environnemental" pour désigner le travail des artistes plaçant l’environnement au centre de leur pratique artistique. L’art écologique va plus loin : il désigne non seulement cette démarche esthétique, mais la double d’une approche engagée.
Ainsi, l’art écologique est par nature interdisciplinaire, croisant l’art, les sciences, la politique ou bien encore la géographie. Les artistes mettent la lumière sur l’environnement dans lequel nous évoluons, tantôt pour sensibiliser leur audience à la présence et la beauté de la nature, tantôt pour les inviter à repenser le rapport que nous entretenons avec elle. Ce grand mouvement se détaille en plusieurs sous-courants artistiques qui, chacun à leur manière, replacent la nature au centre de nos interactions. Zoom sur trois grandes familles.
Land art : l’art de modeler le paysage en oeuvre éphémère
Notre première famille d'artistes utilise son environnement naturel pour créer. Le land art émerge au milieu du XXe siècle et se caractérise par des installations « in situ », c’est-à-dire intégrant les œuvres au sein même de leur lieu de création. La nature est à la fois support et œuvre à part entière.


L’artiste plasticien allemand Nils Udo est l’un des pionniers en la matière, et ce dès les années 1970. Considérant que la nature est art, il mêle sculpture, peinture et installations pour montrer sa beauté. Plus contemporain, l’artiste français Saype utilise une peinture biodégradable pour son immense projet Beyond Walls, qui vise à créer « la plus grande chaîne humaine au monde » et à célébrer la singularité humaine et la solidarité. Le land art est par essence éphémère car soumis aux conditions climatiques et à la biodégradation naturelle. La photographie est donc une allié précieuse de l’artiste pour que la trace, à défaut de l’œuvre, perdure.



Plus récent, le "green street art" est un type d’art proche du land art, qui mêle travail in situ dans un territoire urbain et influence de la nature. Le mouvement est né dans les années 2000, initialement pour porter des revendications écologiques.
Trash art : l’art de créer à partir d’un rien
Notre deuxième famille détourne de manière ingénieuse les laissés-pour-compte de la société : les déchets. Le trash art émerge au même moment que le land art, sous forme d’anti-art visant à critiquer la société de consommation et les courants artistiques de l’époque.
Le trash art moderne est adepte de l’upcycling des débris, qu’il réutilise ou détourne en objet artistique. Le trash-artiste est un nouveau genre de sculpteur qui invite au questionnement sur les conséquences de nos modes de consommation et de gaspillage.

Tim Noble et Sue Webster, duo d’artistes britanniques de renom, utilisent ainsi l’ombre et la lumière pour transformer leurs sculptures de déchets en une œuvre artistique grâce à de la lumière projetée. À première vue chaotique, la pile de débris est savamment pensée et chaque élément permet de donner vie à une ombre poétique.
D’autres artistes ont des revendications plus affirmées, c’est le cas de la sculptrice américaine Angela Haseltine Pozzi et de son projet Washed Ashore. Les détritus ramassées lors des nettoyages de plages sont transformés en immenses sculptures de poissons, requins, méduses et autres animaux marins, formant une vaste exposition itinérante. Né d’une prise de conscience de la pollution marine et de ses conséquences, le projet est à la fois artistique, éducatif et collaboratif.

Écovention et artivisme : l’art de servir une cause commune
Notre troisième grande famille se sert de l’art comme outil de restauration ou outil militant. L’Ecovention – savant mélange d’écologie et d’intervention – apparaît à la fin du XXe siècle. Il se distingue par son usage de l’art à des fins de restauration d’espaces naturels endommagés et pollués. Il s’intéresse à améliorer, transformer durablement le paysage en apportant une solution artistique.

Stacy Levy, sculptrice américaine, et son projet Spiral Wetland en sont un bel exemple. Le projet naît du constat de la pollution du lac Fayetteville (US). Soutenu par le Walton Art Center, Stacy Levy crée des zones marécageuses en forme de spirale pour assainir l’eau et recréer de la biodiversité. La démarche est à la fois artistique et scientifique, et restaure la vie marine du lac.
La deuxième utilisation commune de l’art comme outil citoyen est l’artivisme, qui enchevêtre art et activisme. Dans ce courant, l’art sert activement une cause et soutient explicitement l’engagement citoyen pour sensibiliser les individus aux conséquences des décisions politiques. Parfois choquant, toujours engagé, l’artivisme prend de nombreuses formes telles que la danse, le théâtre, la sculpture ou encore la photographie.

Dans cette photographie tirée de la série « L’enfer du cuivre » de Nyaba Ouedraogo, l’artiste relate le problème de l’envoi de déchets électroniques occidentaux au Ghana et de leurs impactent sur la vie des habitants dans des images poignantes visant à faire prendre conscience des dégâts humains et environnementaux que le système engendre.
Tous ces mouvements artistiques invitent à repenser le rapport de l’humain à ses pairs, à la faune et la flore, tantôt de manière provocatrice, tantôt de manière poétique. Tous portent en leur sein des revendications sociales, écologiques ou culturelles. En refaçonnant notre imaginaire, en mélangeant art, sciences, ingénierie et même philosophie, ils nous permettent de nous questionner et de transformer notre vision du monde. Et par extension, à transformer le monde lui-même.